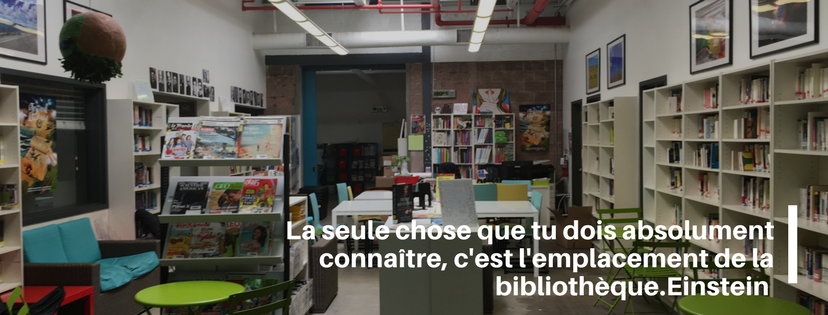Sens et Non-sens de Merleau-Ponty
MDecriem
Vos commentaires, impressions...
Le doute de Cezanne
Merleau-Ponty commence son analyse sur l’art en se focalisant sur Cézanne. Il décrit son mode de travail, qui l’amenait a plus de « cent de séances de travail » pour peindre, ainsi que son caractère. Ses contemporains le considérait comme un échec, soit dans son art, soit dans son caractère.
Son caractère irascible et presque pathologique comme le décrit Merleau-Ponty éloignait tout le monde. Il refusait le contact physique et haïssait la discussion. Résultat, cela influençait négativement la pensée des gens sur ses œuvres. Même ses amis les plus proches, tel que Zola et Emile Bernard, l’ont considéré comme un échec alors qu’au début, ils l’appelaient un « génie avorte ». A cause de son caractère, on ne considérait pas ses œuvres comme bonnes, ses contemporains proches se concentraient plus sur son caractère qu’a son art, sans jamais considérer les deux.
Quant à ceux qui ne le connaissait pas, ils considéraient ses œuvres comme des « peintures de vidangeur saoul ». On critiquait son art et sa vision des choses, sans jamais vouloir les comprendre. Cela peut se comprendre car le fait que Cézanne voulait peindre un portrait comme un objet pouvait lui donner un aspect inhumain.
Ceci constitue les premières pages du livre, et sont plutôt facile a lire et a comprendre. Le reste de l’analyse devient parfois plus complexe, et j’ai dus lire des passages plusieurs fois pour tout comprendre.
Cézanne est face à lui-même lorsqu’il peint, et est seul dans sa contemplation de la nature. Ainsi, personne ne peut le critiquer et l’influencer dans son travail. Il peut ainsi connaître la nature de lui-même, avec le regard critique d’un Homme. Il construit lui-même sa vision des choses et les interprète pour les peindre. Cela ne s’applique pas a seulement a Cézanne mais aussi a chaque artiste. Pour réussir, ils doivent faire face à la nature par eux-mêmes et créer leurs propres opinions sans chercher à savoir celle du peuple. De plus, le sens de son œuvre ne peut pas être déterminé par la vie de l’artiste. Son art n’est pas la répercussion de sa vie, c ‘est même le contraire. L’œuvre de Cézanne l’a force à avoir la vie qu’il avait. C’est parce qu’il cherchait a peindre son art qu’il s’est distance des gens, qu’il s’est créé ce mode de vie. Sans son caractère et sa vie étrange, son art n’aurait pas peu existe, car il n’aurait pas suivi la vie nécessaire a son art. Sa vie et son œuvre se joignent alors pour former une seule aventure, qui mêle le passe et le futur, et peut être considère comme une 4eme inconditionnée car elle serait une cause originelle.
En parlant de son art, on peut d’ailleurs mentionner que ses premiers tableaux sont des « rêves peints, ils viennent des sentiments et veulent provoquer des sentiments ». Ils seraient alors des copies de la réalité de Cézanne, de ce qu’il voit. On a par exemple un Meurtre ou un Enlèvement, ce sont des rêves nécessaires à l’art de Cézanne. De plus, on voit dans ces les marques d’impressionnismes, ils cherchent a toucher le lecteur comme n’importe quel artiste. L’art fonderait notre vie, mais se reposerai aussi dessus, car c’est par ce qu’i l connaît que l’artiste peut exprimer ses sentiments. Il est alors en quête d’un art qui lui convient, qui lui permet d’exprimer sa pensée. Ses premiers tableaux ne seraient alors que des tentatives d’expression, il essaye de mettre en peinture ses émotions et pensées. Ce sont alors les bases de son art, qui vont l’aider à s’améliorer.
Plus tard, on en apprend plus sur l‘art de Cézanne. D’abord, il ne cherche pas à représenter l’aspect physique de son objet d’étude, il veut le représenter dans le mouvement, dans sa « physionomie morale ». Cézanne cherche à rendre même un vase vivant, il cherche à lui instaurer un nouveau sens, à le rendre réel. Cézanne ne cherche pas à imiter la réalité, mais à en créer une autre, à donner à la peinture une autre dimension, un but que chaque artiste vise. Cézanne ne cherche maintenant plus à peindre ses rêves, mais à peindre « l’étude précise des apparences ». Il ne s’intéresse pas ici au physique de l’objet, comme dit précédemment, mais à le définir. Il le cerne de toutes les cotes pour s’en approprier les caractéristiques et créer un nouvel objet, similaire dans l’existence mais différent dans son essence. De plus, Cézanne ne fait pas un travail d’atelier, qui sous-entend une imitation de la réalité, mais un travail sur la nature. Il s’en inspire et la contemple, il « germine avec elle », pour la retranscrire sur son tableau, elle, la base fondatrice de son art.
On voit ensuite pourquoi Cézanne s’est dissocie de l’impressionnisme. C’est simple, « l’impressionnisme voulait rendre dans la peinture la manière même dont les objets frappent notre vue et attaquent nos sens » mais se focalisait trop sur la peinture de l’atmosphère et la division des tons. Bref, Cézanne ne pouvait être d’accord sur ce fait, car il pensait noyer l’objet ainsi que la pesanteur propre. Avec l’impressionnisme, il détruisait l’objet, ainsi que ce qui nous maintient, la pesanteur, ce serait comme enlevé toute forme d’ordre et créer l’anarchie.
Cézanne se dissocie alors de l’impressionnisme par plusieurs choses. Il commence d’abord avec sa palette de 18 couleurs au lieu de 7, qui montre son désir de retrouver l’objet derrière l’atmosphère, de le rendre à la fois radiant et associes au fond. Cézanne cherche a éclairer l’objet « sourdement de l’intérieur », il veut que l’objet n’est nul besoin de support pour se faire remarquer, il devient unique et réel, car il donne « une impression de solidité et matérialité ». Il montre encore ici son but, forger l’art comme réalité et non comme une imitation.
Cézanne rechercherait « la réalité sans quitter la sensation », un paradoxe que Bernard appelle le suicide Cézanne, car « il vise la réalité et s’interdit les moyens de l’atteindre ». C’est à dire qu’en se reliant sur les sens, il est prône à mal distinguer la réalité de sa perception des choses. Mais c’est ainsi que Cézanne construit son art, il n’omet rien et se repose sur la nature, même ce qui peut l’induire en erreur. Ainsi, chaque coup de pinceau de Cézanne « porte en lui ce Tout indivisible » qui contient toute la nature. Il est nécessaire si le peintre veut exprimer le monde, car la peinture est avant toute chose une allusion aux choses, elle se retrouve dans l’expérience du spectateur et chez le peintre qui doit interpréter le tableau. C’est d’ailleurs ce que sous-entend Cézanne lorsqu’il dit de peindre un « comme un objet ». Il ne le dépouille pas de sa pensée, il entends « que le peintre l’interprète » sans se séparer de la vision. La création et l’expression d’une nouvelle réalité est alors une tache infinie car « chaque touche donnée doit satisfaire une infinité de conditions ».
Enfin, le but de Cézanne est de faire voir comment le monde nous touche. Il veut peindre « L’esprit qui se voit et se lit dans les regards » mais ceci n’est pas chose facile. En prenant l’exemple de Balzac, Cézanne voulait peindre une scène de la Peau de Chagrin mais il lui était impossible de peindre toute la phrase. Cela prouve qu’il est alors impossible de retranscrire la réalité exactement et qu’un équilibre est nécessaire pour pouvoir peindre ce que l’on interprète. L’art peut alors être qualifie de science intuitive, c’est une science dans laquelle on assume la culture depuis son début pour la fonder a nouveau. L’artiste est alors comme un livre vierge qui se remplit de lui-même.
Le but de Cézanne s’accompagne de plusieurs doutes et questions. Il se demande comment l’atteindre car n’étant que mortel, n’est-il pas impuissant ? Pour lui, il faudrait créer et exprimer une idée, puis réveiller les expériences enracinées dans les consciences. Il cherche donc à viser le passe pour créer un sentiment de familiarité et se permettre de touche la masse populaire.
Finalement vient la question de liberté. L’artiste est-il prisonnier de son œuvre et de ce qui l’entoure ? Nous ne voyons que devant nous et ce qui est nous même. Nous avançons vers un futur incertain, avec un voile jeté sur notre vision. La vie semble alors avoir la forme d’un projet déjà accompli, et tout nous semble spontané ou prédestiné à un avenir. Cela s’applique même a nos qualités qui rend impossible de distinguer l’inné ou l’acquis/le spontané ou le nouveau.
Pourtant, s’il y a une liberté vraie, elle sera trouve durant la vie, et nous changerons de situation sans cesser d’être le même. Nous devons parvenir à nous séparer pour pouvoir changer et rester la même personne, car nous ne sommes jamais déterminés mais nous ne changeons jamais. Il en vient a nous de mélanger ces deux concepts comme l’a fait Da Vinci. Selon Paul Valery, ses peintures décrivaient un monstre de liberté pure, il n’existait rien de moins humain. Déjà au tout début, il a le choix, soit il fuit, soit il cède à son enfance, mais lui comprend les mécanismes de ces pièges et les désactive. Il semble à la fois maitre de lui-même et prédestinés, comme pour l’amour, où toutes les places de son cœur semblaient déjà occupées. Ainsi, Leonard est libre car il a réussi a change tout en restant le même, en gardant des traits juvéniles, des caractéristiques innées.
Merleau-Ponty commence son analyse sur l’art en se focalisant sur Cézanne. Il décrit son mode de travail, qui l’amenait a plus de « cent de séances de travail » pour peindre, ainsi que son caractère. Ses contemporains le considérait comme un échec, soit dans son art, soit dans son caractère.
Son caractère irascible et presque pathologique comme le décrit Merleau-Ponty éloignait tout le monde. Il refusait le contact physique et haïssait la discussion. Résultat, cela influençait négativement la pensée des gens sur ses œuvres. Même ses amis les plus proches, tel que Zola et Emile Bernard, l’ont considéré comme un échec alors qu’au début, ils l’appelaient un « génie avorte ». A cause de son caractère, on ne considérait pas ses œuvres comme bonnes, ses contemporains proches se concentraient plus sur son caractère qu’a son art, sans jamais considérer les deux.
Quant à ceux qui ne le connaissait pas, ils considéraient ses œuvres comme des « peintures de vidangeur saoul ». On critiquait son art et sa vision des choses, sans jamais vouloir les comprendre. Cela peut se comprendre car le fait que Cézanne voulait peindre un portrait comme un objet pouvait lui donner un aspect inhumain.
Ceci constitue les premières pages du livre, et sont plutôt facile a lire et a comprendre. Le reste de l’analyse devient parfois plus complexe, et j’ai dus lire des passages plusieurs fois pour tout comprendre.
Cézanne est face à lui-même lorsqu’il peint, et est seul dans sa contemplation de la nature. Ainsi, personne ne peut le critiquer et l’influencer dans son travail. Il peut ainsi connaître la nature de lui-même, avec le regard critique d’un Homme. Il construit lui-même sa vision des choses et les interprète pour les peindre. Cela ne s’applique pas a seulement a Cézanne mais aussi a chaque artiste. Pour réussir, ils doivent faire face à la nature par eux-mêmes et créer leurs propres opinions sans chercher à savoir celle du peuple. De plus, le sens de son œuvre ne peut pas être déterminé par la vie de l’artiste. Son art n’est pas la répercussion de sa vie, c ‘est même le contraire. L’œuvre de Cézanne l’a force à avoir la vie qu’il avait. C’est parce qu’il cherchait a peindre son art qu’il s’est distance des gens, qu’il s’est créé ce mode de vie. Sans son caractère et sa vie étrange, son art n’aurait pas peu existe, car il n’aurait pas suivi la vie nécessaire a son art. Sa vie et son œuvre se joignent alors pour former une seule aventure, qui mêle le passe et le futur, et peut être considère comme une 4eme inconditionnée car elle serait une cause originelle.
En parlant de son art, on peut d’ailleurs mentionner que ses premiers tableaux sont des « rêves peints, ils viennent des sentiments et veulent provoquer des sentiments ». Ils seraient alors des copies de la réalité de Cézanne, de ce qu’il voit. On a par exemple un Meurtre ou un Enlèvement, ce sont des rêves nécessaires à l’art de Cézanne. De plus, on voit dans ces les marques d’impressionnismes, ils cherchent a toucher le lecteur comme n’importe quel artiste. L’art fonderait notre vie, mais se reposerai aussi dessus, car c’est par ce qu’i l connaît que l’artiste peut exprimer ses sentiments. Il est alors en quête d’un art qui lui convient, qui lui permet d’exprimer sa pensée. Ses premiers tableaux ne seraient alors que des tentatives d’expression, il essaye de mettre en peinture ses émotions et pensées. Ce sont alors les bases de son art, qui vont l’aider à s’améliorer.
Plus tard, on en apprend plus sur l‘art de Cézanne. D’abord, il ne cherche pas à représenter l’aspect physique de son objet d’étude, il veut le représenter dans le mouvement, dans sa « physionomie morale ». Cézanne cherche à rendre même un vase vivant, il cherche à lui instaurer un nouveau sens, à le rendre réel. Cézanne ne cherche pas à imiter la réalité, mais à en créer une autre, à donner à la peinture une autre dimension, un but que chaque artiste vise. Cézanne ne cherche maintenant plus à peindre ses rêves, mais à peindre « l’étude précise des apparences ». Il ne s’intéresse pas ici au physique de l’objet, comme dit précédemment, mais à le définir. Il le cerne de toutes les cotes pour s’en approprier les caractéristiques et créer un nouvel objet, similaire dans l’existence mais différent dans son essence. De plus, Cézanne ne fait pas un travail d’atelier, qui sous-entend une imitation de la réalité, mais un travail sur la nature. Il s’en inspire et la contemple, il « germine avec elle », pour la retranscrire sur son tableau, elle, la base fondatrice de son art.
On voit ensuite pourquoi Cézanne s’est dissocie de l’impressionnisme. C’est simple, « l’impressionnisme voulait rendre dans la peinture la manière même dont les objets frappent notre vue et attaquent nos sens » mais se focalisait trop sur la peinture de l’atmosphère et la division des tons. Bref, Cézanne ne pouvait être d’accord sur ce fait, car il pensait noyer l’objet ainsi que la pesanteur propre. Avec l’impressionnisme, il détruisait l’objet, ainsi que ce qui nous maintient, la pesanteur, ce serait comme enlevé toute forme d’ordre et créer l’anarchie.
Cézanne se dissocie alors de l’impressionnisme par plusieurs choses. Il commence d’abord avec sa palette de 18 couleurs au lieu de 7, qui montre son désir de retrouver l’objet derrière l’atmosphère, de le rendre à la fois radiant et associes au fond. Cézanne cherche a éclairer l’objet « sourdement de l’intérieur », il veut que l’objet n’est nul besoin de support pour se faire remarquer, il devient unique et réel, car il donne « une impression de solidité et matérialité ». Il montre encore ici son but, forger l’art comme réalité et non comme une imitation.
Cézanne rechercherait « la réalité sans quitter la sensation », un paradoxe que Bernard appelle le suicide Cézanne, car « il vise la réalité et s’interdit les moyens de l’atteindre ». C’est à dire qu’en se reliant sur les sens, il est prône à mal distinguer la réalité de sa perception des choses. Mais c’est ainsi que Cézanne construit son art, il n’omet rien et se repose sur la nature, même ce qui peut l’induire en erreur. Ainsi, chaque coup de pinceau de Cézanne « porte en lui ce Tout indivisible » qui contient toute la nature. Il est nécessaire si le peintre veut exprimer le monde, car la peinture est avant toute chose une allusion aux choses, elle se retrouve dans l’expérience du spectateur et chez le peintre qui doit interpréter le tableau. C’est d’ailleurs ce que sous-entend Cézanne lorsqu’il dit de peindre un « comme un objet ». Il ne le dépouille pas de sa pensée, il entends « que le peintre l’interprète » sans se séparer de la vision. La création et l’expression d’une nouvelle réalité est alors une tache infinie car « chaque touche donnée doit satisfaire une infinité de conditions ».
Enfin, le but de Cézanne est de faire voir comment le monde nous touche. Il veut peindre « L’esprit qui se voit et se lit dans les regards » mais ceci n’est pas chose facile. En prenant l’exemple de Balzac, Cézanne voulait peindre une scène de la Peau de Chagrin mais il lui était impossible de peindre toute la phrase. Cela prouve qu’il est alors impossible de retranscrire la réalité exactement et qu’un équilibre est nécessaire pour pouvoir peindre ce que l’on interprète. L’art peut alors être qualifie de science intuitive, c’est une science dans laquelle on assume la culture depuis son début pour la fonder a nouveau. L’artiste est alors comme un livre vierge qui se remplit de lui-même.
Le but de Cézanne s’accompagne de plusieurs doutes et questions. Il se demande comment l’atteindre car n’étant que mortel, n’est-il pas impuissant ? Pour lui, il faudrait créer et exprimer une idée, puis réveiller les expériences enracinées dans les consciences. Il cherche donc à viser le passe pour créer un sentiment de familiarité et se permettre de touche la masse populaire.
Finalement vient la question de liberté. L’artiste est-il prisonnier de son œuvre et de ce qui l’entoure ? Nous ne voyons que devant nous et ce qui est nous même. Nous avançons vers un futur incertain, avec un voile jeté sur notre vision. La vie semble alors avoir la forme d’un projet déjà accompli, et tout nous semble spontané ou prédestiné à un avenir. Cela s’applique même a nos qualités qui rend impossible de distinguer l’inné ou l’acquis/le spontané ou le nouveau.
Pourtant, s’il y a une liberté vraie, elle sera trouve durant la vie, et nous changerons de situation sans cesser d’être le même. Nous devons parvenir à nous séparer pour pouvoir changer et rester la même personne, car nous ne sommes jamais déterminés mais nous ne changeons jamais. Il en vient a nous de mélanger ces deux concepts comme l’a fait Da Vinci. Selon Paul Valery, ses peintures décrivaient un monstre de liberté pure, il n’existait rien de moins humain. Déjà au tout début, il a le choix, soit il fuit, soit il cède à son enfance, mais lui comprend les mécanismes de ces pièges et les désactive. Il semble à la fois maitre de lui-même et prédestinés, comme pour l’amour, où toutes les places de son cœur semblaient déjà occupées. Ainsi, Leonard est libre car il a réussi a change tout en restant le même, en gardant des traits juvéniles, des caractéristiques innées.
mathieu.bonin@lilaschool.com
Le texte de Neil me frappe (aie!) ! Neil parvient à raconter ce petit Essai en redonnant l'atmosphère de l'écriture de Merleau-Ponty des derniers textes (avant qu'il meurt ... un peu jeune il est vrai). L'analyse de la perception doit échapper à la dissection trop tranchante des concepts, pour cela le style, le propos de MP sera plus littéraire, plus opaque, plus suggestif, comme c'est le cas dans cet extrait.
Peut être que Neil aurait du mettre l'accent davantage et plus fortement sur le concept de perception. Dans la phénoménologie de l'esprit, MP cherche à réhabiliter le corps, qui selon lui et dans une longue tradition a été oublié ou négligé par les philosophes. Oui, l’esprit est évidemment supérieur au corps, chez Platon, l’âme est immortelle le corps périssable, chez Descartes, le corps est une machine l’âme est le siège de la pensée. Le corps est l’inessentiel, le support, le substrat de notre intelligence. Or Pour Merleau Ponty, et pour toute une tradition de la phénoménologie, le corps n’est pas ce tat de chaire, ce tat d’organe, le corps est tout simplement notre premier contact avec le monde. Avant même que nous pensions, que nous utilisions le langage, nous sentons le monde, nous le percevons. Cette perception est bien plus qu’une somme de stimuli, notre corps appréhende le monde avec une intelligence qui n’est pas l’intelligence de la raison. C’est ce que MP appelle être au monde. Dès lors, après s’être longtemps intéressé à la psychologie de la perception, MP va s’intéresser au Artiste et notamment à Cézanne. Ce peinte en effet était un obsédé de la perception. Cézanne voulait diluer sa propre perception dans la peinture pour tenter de retrouver les objets eux-mêmes dans ce qu’ils ont de plus primordial. Cet aspect de la perception serait une vision des choses, de la nature, avant que notre perception soit pétrie d’habitude de concepts, d’une vision utilitaire. Cézanne veut retrouver la roche, la chair de la roche au delà de ce que nous en savons, de comment nous la percevons. Voilà pourquoi la peinture de Cézanne va au delà de l’impressionnisme et tend parfois à la dissolution de ce qu’elle peint.
Les remarques sur le rapport à l’imitation sont en tout cas une clef d’entrée dans ce texte. Quand au travail il est je crois est particulièrement réussi.
Peut être que Neil aurait du mettre l'accent davantage et plus fortement sur le concept de perception. Dans la phénoménologie de l'esprit, MP cherche à réhabiliter le corps, qui selon lui et dans une longue tradition a été oublié ou négligé par les philosophes. Oui, l’esprit est évidemment supérieur au corps, chez Platon, l’âme est immortelle le corps périssable, chez Descartes, le corps est une machine l’âme est le siège de la pensée. Le corps est l’inessentiel, le support, le substrat de notre intelligence. Or Pour Merleau Ponty, et pour toute une tradition de la phénoménologie, le corps n’est pas ce tat de chaire, ce tat d’organe, le corps est tout simplement notre premier contact avec le monde. Avant même que nous pensions, que nous utilisions le langage, nous sentons le monde, nous le percevons. Cette perception est bien plus qu’une somme de stimuli, notre corps appréhende le monde avec une intelligence qui n’est pas l’intelligence de la raison. C’est ce que MP appelle être au monde. Dès lors, après s’être longtemps intéressé à la psychologie de la perception, MP va s’intéresser au Artiste et notamment à Cézanne. Ce peinte en effet était un obsédé de la perception. Cézanne voulait diluer sa propre perception dans la peinture pour tenter de retrouver les objets eux-mêmes dans ce qu’ils ont de plus primordial. Cet aspect de la perception serait une vision des choses, de la nature, avant que notre perception soit pétrie d’habitude de concepts, d’une vision utilitaire. Cézanne veut retrouver la roche, la chair de la roche au delà de ce que nous en savons, de comment nous la percevons. Voilà pourquoi la peinture de Cézanne va au delà de l’impressionnisme et tend parfois à la dissolution de ce qu’elle peint.
Les remarques sur le rapport à l’imitation sont en tout cas une clef d’entrée dans ce texte. Quand au travail il est je crois est particulièrement réussi.
Répondre à ce message
Vous n'êtes pas autorisé à poster un message sur le forum.